GUESTS
THIERRY GARREL

ex-responsable des documentaires sur ARTE , consultant
HERVE GAUVILLE

Ecrivain, critique d’art. Hervé Gauville est né en 1949 à Bayonne. Journaliste à Libération de 1981 à 2006, il est l’auteur d’ouvrages sur l’art moderne et contemporain notamment de Régine Chopinot (Armand Colin, 1990), Gazettes, chroniques d’art & autres passe-temps (André Dimanche, 1993), Parade (Actes Sud, 1999), Nothing is lighter than light. Markus Raetz (Maison européenne de la photo, 2003), et, récemment dans une nouvelle édition, de L’art depuis 1945 (Hazan, 2007). Il est aussi l’auteur d’œuvres de fiction : Le cahier bleu (Julliard, 1990), Crier gare (Verticales, 2001), L’homme au gant (Verticales, coll. « Minimales », 2005) et Ci-gisent, en collaboration avec Franck du Boucher (Les Impressions Nouvelles, 2007).
PATRICK LEBOUTTE

Spécialiste du film documentaire, critique de cinéma et essayiste, né à Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles) en 1960. Il enseigne l'Histoire du cinéma à l'INSAS (Bruxelles).
Il dirige la collection Le geste cinématographique aux Éditions Montparnasse. Il conçoit ou programme régulièrement des manifestations cinématographiques et anime de nombreux séminaires, en Belgique comme en France, dans l'esprit de la revue L'image, le monde qu'il cofonda en 1999 et dont il fut le rédacteur en chef.
Il est auteur de l'ouvrage devenu une référence Ces films qui nous regardent, Une approche du cinéma documentaire (éditions La Médiathèque de la Communauté française de Belgique, 2002.)
De 1986 à 1996, il fut directeur littéraire aux éditions Yellow now où il dirigea notamment les collections Long métrage (centrée sur l'analyse de films) et De parti pris. Pour ce même éditeur, il coordonna plusieurs ouvrages dont Une encyclopédie des cinémas de Belgique (1990, codirigé avec Guy Jungblut et Dominique Païni, Musée d’art moderne de la Ville de Paris - Editions Yellow Now), Une Encyclopédie du nu au cinéma (1994, codirigé avec Alain Bergala et Jacques Déniel) et Cinégénie de la bicyclette (1995, écrit avec Gilles Cornec et Hervé Le Roux.)
Il a signé le manifeste pour la culture wallonne en 1983, alors qu'il était jeune étudiant à l'ULg, où il a suivi les cours du professeur Klinkenberg.
MARIE BALDUCCHI

Productrice Agat Films
JEAN-NOEL CHRISTIANI

Réalisateur, formateur aux Ateliers Varan
CLAUDE GUISARD
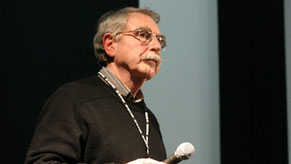
Ex-producteur à l’Institut National de l’Audiovisuel, producteur, président des Ateliers Varan.
D’abord journaliste de radio et de télévision de 1962 à 1966, Claude Guisard a exercé différentes responsabilités dans plusieurs secteurs de la télévision publique, à l’ORTF, dont le Service de la Recherche de Pierre Schaeffer, puis à l’Ina, jusqu’à sa mise à la retraite fin 1999, alors directeur des programmes de création et de recherche de l’Ina depuis 25 ans.
ESTHER HOFFENBERG

Réalisatrice de Au pays du nucléaire
En 1980, elle coréalise et coproduit Comme si c'était hier en collaboration avec Myriam Abramowicz. Premier film à s'intéresser aux justes et au sort des enfants cachés en Belgique, il reçoit le Red Ribbon Award à l'American Film Festival1, une mention spéciale du Prix Femina belge et sort en salle à New York, Bruxelles et Paris.
En 2009, Esther Hoffenberg réalise Au pays du nucléaire. Ce film est le fruit d'une enquête approfondie sur tous les sites nucléaires concentrés à La Hague, notamment sur la question de l’irréversibilité. Le film nous fait approcher un ensemble de sujets de société brûlants (la toute-puissance d’une mono-industrie, le rôle essentiel des associations, le désarroi d’une population « éduquée » par les communicants de l’industrie nucléaire). Le film est diffusé en septembre 2009 sur France 2 (Infrarouge).La même année, Esther Hoffenberg réalise et produit Récits de Sam. Le film revisite des entretiens intimes, filmés en amateur, avec son père, Sam Hoffenberg, survivant du ghetto de Varsovie et du Camp de Poniatowa. Le film a été diffusé sur France 3 (Libre-Court).
Esther Hoffenberg a réalisé en 2013 un film documentaire sur l'écrivain Violette Leduc, produit par Les Films du Poisson et Arte-France.
ALICE DIOP

Réalisatrice de La mort de Danton.
La réalisatrice Alice Diop est née en France, de parents sénégalais. En passant un mois au Sénégal, munie d’une caméra, elle filme la vie. Elle dresse le portrait de trois femmes de sa famille : Néné et ses deux filles Mouille et Mame Sarr. « Ce film, c’est le portrait d’une cour et des femmes qui y vivent, trois sénégalaises urbaines. Une mère et ses deux filles. Cette cour, c’est un peu la métaphore du gynécée au Sénégal : un espace cloisonné, exclusivement féminin, où, face à l’adversité du quotidien, certaines luttent, tentent de se battre quand d’autres attendent, lézardent et rêvent de partir. »
PENELOPE BORTOLUZZI

Réalisatrice, monteuse (Tahrir)
LAURE MOUALHAT

Journaliste à Libération, réalisatrice (Déchets : le cauchemar du nucléaire)
ARNAUD DOMMERC

Premier assistant réalisateur sur de nombreux longs métrages, Arnaud Dommerc a notamment travaillé avec Robert Guédiguian ou les frères Larrieu. Parallèlement, il a produit de nombreux courts métrages et documentaires qui ont connu pour la plupart une large diffusion publique, ainsi qu'un succès certain auprès des professionnels, notamment son travail avec Dyana Gaye. Deweneti et Un transport en commun ont tous deux été nommés pour le César du Meilleur court métrage en 2008 et 2011.
HORMUZ KEY

Né dans un village aux portes du désert en Iran, il s'installe en France dans les années 80. Il travaille aux côtés de Claude Lelouch et Serge Le Péron, avant de décrocher un doctorat en Arts et Sciences de l'Art, cinéma télévision et audiovisuel, obtenu à la Sorbonne à Paris et dirigé par Marc Ferro. Cette thèse est publié en 1999, sous le titre "Le Cinéma iranien, l'image d'une société en bouillonnement, de La Vache au Goût de la cerise" (éd. Karthala). Chargé de cours à Paris VIII puis Marne-la-Vallée, Hormuz Kéy est également l'auteur de divers articles et textes joués en France. Il se distingue en réalisant des documentaires, FILLES D'IRAN, UN CHEMIN SECRET DANS LA MONTAGNE (2001), SUR LES CHEMINS DU SAVOIR (2002), LES JARDINS DU PARADIS (co-réalisé en 2003) et MUSULMANES DE TEHERAN (2004). LA VIE EST UNE GOUTTE SUSPENDUE, portrait du philosophe, auteur et ancien professeur Christian de Rabaudy, sort sur les écrans français en 2007.
ANDRE S. LABARTHE

Réalisateur, critique, vient présenter ses deux films John Cassavetes et Nanni Moretti.
