THEMARIQUE// NOS HEROINES
LES
FILMS
A NOS AMOURS
MAURICE PIALAT

France, 102’, 1983, couleur
A nos amours témoigne d’un double mystère. Suzanne, incarnée par la jeunesse éblouissante de Sandrine Bonnaire, est une adolescente dont la jouissance insaisissable attire les hommes – Luc, l’américain, Jean-Pierre, Michel… - mais aussi la haine. Celle de la mère, hystérique ; celle du frère, écrivain aux tendances incestueuses. Puis il y a aussi le mystère du père interprété par Maurice Pialat, avec la question énigmatique de son départ. « Je vais vous quitter Suzanne ». A partir de quoi, le film décrit un processus évident de crise collective et de tension personnelle. Ici se joue la relation secrète du père et de la fille mais également le rapport du cinéaste et de la comédienne sous la forme, moins évidente, d’une lutte tragique contre « la tristesse qui durera toujours ». A nos amours
en présence de Sylvie Pialat
ASSASSINAT D'UNE MODISTE
CATHERINE BERNSTEIN

France, 82’, 2006, couleur et N&B
Avec un sens précis de l’Histoire et une attention portée aux plus petits détails, Catherine Bernstein reconstitue l’assassinat de sa grand-tante. Née en 1901 à Neuilly, la jeune élégante Odette Bernstein prend le nom de Fanny Berger pour installer son atelier de modiste rue Balzac, dans le Paris d’avant-guerre. Puis en 1940, on applique les premiers décrets antisémites en France et la traque commence. Fanny la mystérieuse redevient Odette, une citoyenne juive qui est fichée et saisie par des fonctionnaires implacables, condamnée à la mort par la déportation à Auschwitz. C’est un calvaire progressif dont la cinéaste prend en charge la reconstitution, usant des ressources du documentaire pour donner à voir le visage d’une inconnue et la nature de la terrible machine qui l’a exterminée.
En la présence de la réalisatrice
DOCUMENTEUR
AGNES VARDAS

France, 65’, 1980-81, couleur
Avec Sabine Mamou ,Mathieu Demy. Avec Documenteur, Agnès Varda donne en quelque sorte la réplique à son documentaire précédent, Mur, murs (1980), sous la forme, cette fois, d’une fiction détournée. C’est une introspection dans les obsessions d’Emilie, une Française qui vit dans l’anonymat de Los Angeles avec son fils de huit ans, Martin - interprété par Mathieu Demy. Procédant par détours, la cinéaste nous livre un journal proche du home movie. Émilie, c’est elle, Agnès, et Martin, c’est Mathieu, son propre fils. Alors Documenteur parce que documentaire ?
HISTOIRE D'UN SECRET
MARIANA OTERO

France, 95’, 2003, couleur
Tout fait signe sous le regard de Mariana Otero, petite fille dont l’histoire est celle d’un secret bien gardé que la femme cinéaste dévoile ici, 25 ans plus tard. A l’âge de six ans, on apprend à la fillette que sa mère, la peintre Clotilde Vautier, est morte d’une opération de l’appendicite. Le film se déroule alors sous la forme d’une enquête intime que partage sa sœur, l’actrice Isabel Otero, et par laquelle la souffrance se digère, révélant la vérité qui dormait depuis l’enfance clairvoyante. Cinéaste réactive aux paysages comme aux visages, Mariana Otero réalise un tombeau poétique en hommage à la mère mais aussi une création visuelle : son tableau.
en la présence de la réalisatrice
REPONSE DE FEMMES
AGNES VARDA

France, 8’, 1975, couleur
En 1975, la question « Qu'est-ce qu'une femme » est posée par Antenne 2 à plusieurs femmes cinéastes. Agnès Varda donne une des réponses possibles à travers ce ciné-tract militant. Sur un fond blanc, des femmes alignées dans le cadre prennent successivement la parole pour dire la violence et le conditionnement d’une société délibérément machiste.
BEPPIE
JOHAN VAN DER KEUKEN

Pays Bas, 37’,1965
Cinq ans après Zazie dans le métro (un film de fiction de Louis Malle d’après le roman de Raymond Queneau), c’est une autre gamine de 10 ans, unekapanonplusalangdansapoche, qui est l’héroïne - cette fois « documentaire » - de ce petit joyau cinématographique (l’un des premiers films du grand cinéaste néerlandais). Même coupe de cheveux au bol, même œil effronté... Mais plus profonde que la môme de fiction, Beppie (voisine de Johan van der Keuken à Amsterdam) nous transmet, à travers la caméra leste et joueuse du cinéaste (la séquence des sonnettes !), son regard d’enfant frondeur sur la ville, sur la vie, sur la mort, la télé, l’amour, l’argent. Trois ans avant les grandes manifestations étudiantes de mai 68.
A.P.G.
CALLE SANTE FE
CARMEN CASTILLO

France, 156’, 2007
Calle Santa Fé, c’est la rue de Santiago où la vie de Carmen Castillo a basculé un jour d’octobre 1974. Elle y est déjà retourné depuis, mais cette fois, trente trois ans plus tard, c’est un total retour sur soi qu’elle effectue sur ces lieux du crime. Encore une fois remuer les cendres d’un amour perdu, d’un enfant mort, d’un idéal politique piétiné par la dictature de Pinochet… Mais, loin de ressasser sa plainte, elle interroge moins ceux qui furent les témoins du drame, que l’image du héros, et surtout celle de la veuve du héros. Tout au long de ce patient parcours, elle se soumet, avec une rayonnante honnêteté, à la question de l’utilité du sacrifice de sa vie qui fut leur credo. Elle écoute la jeunesse chilienne d’aujourd’hui qui ne veut pas de mausolées. Elle cherche la vie dans ce qui fut pour elle un territoire de mort. Un voyage intime dans les replis de l’histoire contemporaine.
A.P.G.
CELLES QUI ONT DE PETITS PIEDS
BAI BUDAN
Chine, 114’, 2005
A l’autre bout du monde aussi, de vieux paysans voient disparaître leur mode de vie. S’ils continuent de travailler leur terre pour survivre, ils voient leurs enfants les quitter pour se débattre dans la jungle des villes. L’autre bout du monde, c’est un village à l’ouest de Pékin. Où vit madame Bai, qui, à 80 ans, est l’une des dernières Chinoises aux pieds bandés. A genoux dans ses champs, elle tente de subsister comme le faisaient les générations avant elle, mais elle sait qu’il lui faut renoncer à transmettre la terre et leur savoir-faire aux enfants. Désormais, il leur faut compter sur eux-mêmes et pas au-delà d’eux-mêmes. Cette fin de vie qui est aussi la fin d’un monde, Budan Bai l’a filmée au rythme lent de ces vieux paysans épuisés, avec l’attention de l’entomologiste, avec l’oeil sensible du peintre. « Il ne faut pas déranger la vie », dit le jeune cinéaste chinois.
A.P.G.
CES FILLES-LA
TAHANI RACHED

De Tahani Rached
Egypte, 68’, 2006
Sélection officielle à Cannes, hors compétition.
Ces filles-là, c’est un groupe de gamines du Caire qui ont choisi – si l’on peut dire - la violence de la rue plutôt que la violence familiale. Fuyant le mauvais sort fait aux femmes dans leur famille, elles ont échoué dans ce cloaque urbain, entre un bistro et un parc. Une sorte de radeau de la méduse où la plus petite risque à tout moment d’être mangée. Mais aussi un territoire féminin libre qu’elles se sont forgé. Un territoire superbe et cruel de drogue, de bagarres, de tendresse aussi. C’est là que ces filles de la rue tentent de se reconstruire une dignité, un avenir. C’est ce phalanstère féminin nocturne hallucinant que Tahani Rached a filmé de longs mois. Muant leur misère en une éblouissante leçon de vie
A.P.G
DANS LA CHAMBRE DE VANDA
PEDRO COSTA
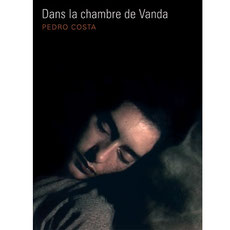
Portugal, 170’, 2000
« Dans Vanda, ce qui est compliqué, c’est que ce n’est pas seulement une fille, c’est le récit d’un quartier, un extérieur qui se passe dans un intérieur. Et aussi le contraire ! C’est ce qui m’intéressait. Si je fais un film sur cette chambre et sur cette fille, c’est un film qui laisse entrer, par la porte ouverte, le quartier, l’argent, l’économie, la mystique, tout passe dans cette chambre ». C’est ainsi que Pedro Costa présente son film dans un interview pour Images documentaires (n°61/62). Le quartier dont il est question est le quartier cap-verdien de Fontainhas à Lisbonne où il a tourné son film suivant, En avant jeunesse ! Depuis, Fontainhas a été détruit.
ELLE S'APPELLE SABINE
SANDRINE BONNAIRE
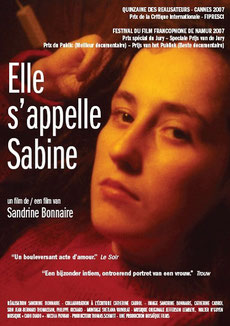
France, 85’, 2007
Sabine qui rit dans les vagues, secoue ses cheveux au soleil, s’émerveille d’un aterrissage à New York… Sabine qui bave, se mord la main, n’arrive plus à soulever son corps lourd… Ces deux vidéos de Sabine, filmées par sa sœur Sandrine Bonnaire, s’entremêlent intimement, douloureusement, pour nous faire comprendre qu’il s’agit bien de la même jeune femme. Entre les deux, un drame familial et cinq années d’hôpital psychiatrique ont eu raison de la joyeuse « différence » de Sabine. Geste d’amour, acte de cinéma, ce premier film de Sandrine Bonnaire pose (et impose) un regard juste et droit sur le sort réservé aux autistes. Un regard éperdu sur l’enfance.
LA FLACA ALEJANDRA
CARMEN CASTILLO

Carmen Castillo
France/Chili, 60’,1994
Près de vingt ans après avoir fui le Chili, passé alors sous la dictature d’Augusto Pinochet, Carmen Castillo revient sur les lieux où la junte a assassiné, sous ses yeux, son compagnon, dirigeant du MIR, organisation d’extrême-gauche devenue clandestine. Ce retour de la cinéaste est une rencontre sidérante avec la part la plus sombre de son histoire qui est aussi celle de son pays : la rencontre avec « la flaca », la militante du MIR qui, sous la torture, les avait dénoncés. Carmen Castillo entamait là une sorte de journal cinématographique, un long travail sur elle-même et sur l’engagement politique.
LES GLANEURS & LA GLANEUSE
AGNES VARDA

France, 82’, 2000
Agnès Varda ouvre son film par une définition tirée du dictionnaire : les glaneurs sont ceux qui, après les récoltes, envahissent les champs pour ramasser ce qu'on a oublié ou simplement écarté des moissons et vendanges. Tout en nous faisant la lecture, elle filme son chat flâneur. Le ton est donné : brillant et léger. La cinéaste dresse alors un catalogue du glanage en prenant comme pièce à conviction le célèbre tableau de Millet Des Glaneuses (1857). Un peu partout en France, elle a récolté la glanure de notre temps, illustrant à son tour ce geste immémorable sur un mode rural - glaner et grapiller - et urbain - récupérer. Qu’ils soient glaneurs ou glaneuses de patates, de raisins, d’huîtres, de télévisions ou de produits emballés, beaucoup cherchent d’abord à survivre dans les rebus de notre civilisation. Mais Agnès Varda est aussi la "glaneuse" du titre et son filmage fonctionne sur le principe même du glanage. Au hasard de la route et des rencontres de passage, elle ajoute et récupère, glanant les plans au petit bonheur la chance...
J.S.
LA MOTIVATION
EMMANUEL GRAS

France, 26’, 2003
Pendant deux ans, Emmanuel Gras écoute et photographie Céline, une jeune maman éprouvée par la vie qui fait preuve de lucidité sur son couple, son avenir et celui de son enfant mais aussi d’une étonnante motivation pour essayer de s’en sortir. Sous la forme d’un photo-roman, le cinéaste agence les images fixes et la parole vive pour faire un portrait dont la justesse dérange sensiblement
LA ROUTE AVEC ELLES
ANNE-SOPHIE BIROT

France, 83’, 2007, couleur
Au printemps 2006, sept vieilles dames drôlement énergiques partent en voyage. Anciennes résistantes, elles se sont battues pour la liberté contre l’occupant allemand sous le régime de Vichy, et ont été déportées à Ravensbrück pour leurs idées. Sous la forme d’un road movie documentaire à la fois grave et joyeux, Anne-Sophie Birot filme ces femmes qui sont accompagnées par une trentaine de lycéens corses. L’objectif : visiter les lieux commémoratifs du passé pour transmettre une Histoire collective aux jeunes générations, leur parler et les faire réfléchir sur le monde d’aujourd’hui, les aider, peut-être, à se forger une conscience politique. La route avec elles est un film sur la nécessité de résister, hier et aujourd’hui.
En la présence de la réalisatrice
PORTRAITS // La matelassière, La cordonnière, La repasseuse, La romancière
ALAIN CAVALIER

France,4 x 13’,1986 à 1991
De 1986 à 1991, Alain Cavalier réalise au total vingt-quatre portraits de femmes exerçant des petits métiers de Paris en voie d'extinction. Filmées avec une équipe réduite selon le même dispositif modeste, ces femmes de tous les jours travaillent sous nos yeux avec un véritable esprit d’indépendance que le cinéaste garde de l’oubli, dans l’élan de ces treize minutes qu’il consacre à chacune d’elles. Alain Cavalier, artisan de cinéma, regarde et écoute la réalité de ces vies, celles de la matelassière, de la cordonnière, de la repasseuse et de la romancière que nous avons choisi de partager avec vous.
LES GLANEURS
AGNES VARDA

Agnès Varda ouvre son film par une définition tirée du dictionnaire : les glaneurs sont ceux qui, après les récoltes, envahissent les champs pour ramasser ce qu'on a oublié ou simplement écarté des moissons et vendanges. Tout en nous faisant la lecture, elle filme son chat flâneur. Le ton est donné : brillant et léger. La cinéaste dresse alors un catalogue du glanage en prenant comme pièce à conviction le célèbre tableau de Millet Des Glaneuses (1857) et illustre à son tour ce geste immémorable sur son mode rural - glaner et grapiller - et urbain - récupérer.
REJANE DANS LA TOUR
DOMINIQUE CABRERA

France, 15’, 1993, couleur
Réjane est une femme de ménage consciencieuse. Plusieurs fois par jour, elle ramasse les papiers et tout ce qui traîne dans les parties communes de la tour. Princesse d’un autre genre, elle s’est laissée enfermée par la vie, prisonnière de ses angoisses suicidaires. Son regard pourtant n’évite pas la caméra, son corps non plus qui déambule dans les couloirs glauques, trop heureuse sans doute de cette délivrance, tout au moins le temps du film.
En la présence de la réalisatrice
HIC ROSA, PARTITION BOTANIQUE
ANNE-MARIE FAUX

France, 53', 2007
« Là-bas, on oublie l’Europe, du moins l’Europe moderne. Imaginez un vaste et grandiose paysage où le contour des montagnes et des vallées se découpe avec une extrême précision. En haut, rien que des blocs de rochers dénudés, d’un gris plein de noblesse. En bas, des oliviers, des lauriers-cerises luxuriants et des châtaigners centenaires. Et partout le silence qui régnait avant la création du monde, pas de voix humaine, pas de cris d’oiseau, rien qu’un ruisseau qui se glisse, quelque part entre les pierres, ou le vent qui chuchote, tout là-haut, dans les failles des rochers, le vent qui gonflait la voile d’Ulysse. Et quand vous rencontrez des êtres humains, ils sont en accord avec le paysage. » En ce début de XXème siècle, Rosa Luxembourg, la révolutionnaire allemande emprisonnée, se souvient de la Corse qu’elle a parcourue à pieds.
En ce début du XXIème siècle, Anne-Marie Faux marche, caméra au poing, sur les traces de Rosa dans le paysage corse.
A.P.G.
JE SUIS CELLE QUI VIENT PORTER LES FLEURS SUR SA TOMBE
HALA ALABDALLA & AMMAR ALBEIK

Syrie/France,110’, 2006
Le titre du film est un vers emprunté à la poétesse syrienne Daed Haddad, disparue en 1991. Il dit l’élan poétique, personnel et finalement politique qui porte cet étrange film. Mine de rien, Hala Alabdalla nous emporte, à travers une sorte de journal intime, images du quotidien mêlées d’entretiens avec des amis artistes, dans les allers-retours qui sont ceux de cette exilée syrienne à Paris. Elle quitte son pays en 1981 pour des raisons politiques. Elle fait ce film en 2006 pour des raisons poétiques. Les deux se rejoignent ici.
A.P.G.
LA JETEE
CHRIS MARKER
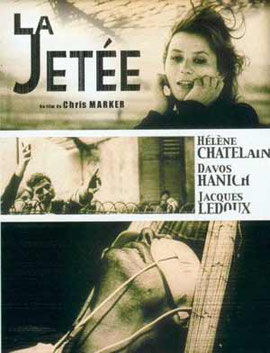
France, 28’, 1962
« Le vertige dont il est question ici (Chris Marker parle de Vertigo d’Alfred Hitchcock) ne concerne pas la chute dans l’espace. Il est la métaphore évidente, saisissable et spectaculaire d’un autre vertige, plus difficile à représenter, le vertige du Temps. » Inspirée par Vertigo, La jetée, à son tour, a inspiré de nombreux autres réalisateurs. L’armée des douze singes de Terry Gilliam (1995) est même une adaptation directe de ce film. La Jetée est un film de science fiction raconté en un sobre roman-photos en noir et blanc. La troisième guerre mondiale. L’apocalypse nucléaire. L’humanité planquée sous terre. Les expériences scientifiques. Un homme hanté par une image d’enfance… La Jetée fut le Prix Jean Vigo 1963.
LIFE ON THEIR SHOULDERS
YESIM USTAOGLU

France/Turquie, 38’, 2004
Komati, à 2000 mètres d’altitude, est la première étape de cette hallucinante transhumance. A l’arrivée de l’été, ces montagnards turcs quittent ainsi leur village pour grimper jusqu’à 3500 mètres et atteindre leur quartier d’été, appelé Grand Kackar, au sommet des chaînes du Pontus. Mais ici, point de mules pour charrier l’ordinaire des bergers. Ce sont les femmes qui portent sur leurs épaules le fardeau d’une vie de transhumance. Yesim Ustaoglu les a filmées au plus près, livrant une vision d’une grande noblesse de cet immense effort pour subsister dans une nature âpre. Nimbées de brouillard, elles se dressent aussi fièrement que les montagnes alentour, entre la Mer Noire et la plateau anatolien. Sous les pluies d’automne, elles reprendront le chemin en sens inverse. La transhumance comme une métaphore.
A.P.G.
MARIA FELIX, L'INSAISISSABLE
CARMEN CASTILLO

Carmen Castillo
France/Mexique, 60’,2001
"Réalité flottante, multiple, visible pour tous, et pour tous insaisissable." C’est ainsi, telle que la décrit Octavio Paz, que l’actrice mexicaine Maria Felix apparaît dans ce film. Celle qui fut la Diva du cinéma mondial de l’après guerre (Dona Barbara en 1943, mais aussi la Lola de Castro du French Cancan de Jean Renoir en 1954), donne à voir, un an avant sa mort, les images de son mythe qu’elle commente d’une voix finement distanciée. Un mythe de la femme fatale que Carmen Castillo sonde obstinément, peut-être pour pénétrer le mystère de ce sourcil parfait qui fit chavirer (entre beaucoup d’autres) Yves Montand. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a… Ici, la vie comme un dîner de gala. Et en passant, à peine maquillée, le regard face caméra, le chagrin, inconsolé, de son enfant perdu.
A.P.G.
MAURICE PIALAT, L' AMOUR EXISTE
ANNE-MARIE FAUX & JEAN-PIERRE DEVILLERS
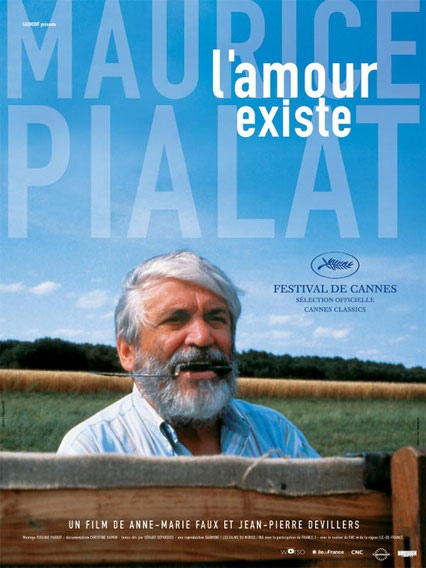
France, 90’, 2007
« Le cinéma de Maurice Pialat est parcouru par une évidence : ce qui se vit, se dit, s’invente, se défait dans la « vraie » vie résonne - le plus souvent en échos fracassants - un jour ou l’autre, dans les films. Ce sont de ces correspondances dont nous sommes partis pour tracer une forme d’auto-portrait, celui d’un cinéaste qui n’oublia jamais ce que fut l’enfance et ne voulut rien céder quant à ce qu’aimer veut dire. » C’est ainsi que les réalisateurs ont présenté le synopsis de ce portrait du grand cinéaste Maurice Pialat, disparu en 2003. Le titre du documentaire est la reprise de celui du premier court métrage de Pialat, réalisé en 1960. A l’époque, L’amour existe du jeune Maurice Pialat obtint le Prix Louis Delluc.
A.P.G.
ROME BRULE, PORTRAIT DE SHIRLEY CLARKE
ANDRE S. LABARTHE

France, 55’, 1970
Entre 1964 et 1972, le magazine "Cinéastes de notre temps" s’offrit, en télévision (alors l’ORTF), un remarquable espace cinéphilique. Son principe, coulé dans le marbre par Janine Bazin (la femme du critique André Bazin) et André S. Labarthe (alors critique aux Cahiers du cinéma): un jeune cinéaste brosse le portrait (en toute liberté de conception) d’un des maîtres du cinéma. Ici, l’un de ces remarquables et disparates regards sur le cinéma d’auteur. Ce portrait de Shirley Clarke, cinéaste américaine engagée et « non conformiste », par André S. Labarthe, cinéaste, non moins « engagé » et non conformiste.
Le magazine de Bazin et Labarthe reprendra en 1989, sous le titre « Cinéma, de notre temps », sur la chaîne Arte.
A.P.G.
